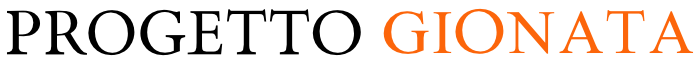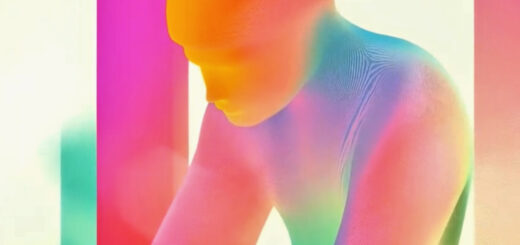Pasolini et "la terre vue de la lune"
.
Réflexions de Luciano Ragusa
Après l'expérience de Oiseaux et oiseaux (1966), Pasolini décide de faire un film épisodique mettant en vedette les mêmes Totò et Ninetto Davoli, avec l'intention d'approfondir sa veine comique et de proposer un point de vue désenchanté sur le monde. Le projet, qui aurait dû être appelé Qu'est-ce que le cinéma?ou Sifandinate, il est réduit lorsque le producteur Dino de Laurentis lui propose de participer à un film collectif intitulé Sorcière, à côté des réalisateurs Bolognini, Rosi, Visconti et De Sica.
L'idée du film est de faire pivoter les histoires sur le thème de la femme sorcière, un sujet loin des thèmes du réalisateur frioulian, qui répond cependant à la proposition en décollant une sorte de bande dessinée descendante Buro et la marionnette.
Il est né comme ça La terre vue de la lune, qui raconte les actes de Ciancicato Miao (totò) et de son fils Baciù (Ninetto Davoli), à la recherche de sa femme et de sa mère idéales pour sa famille surréaliste: la protagoniste féminine absolue, non seulement de cet épisode, mais de tout le film, est Silvana Mangano, qui est responsable de représenter dans différentes nuances le concept de Witch.
Bien que le Mediumometraggio ait été considéré par de nombreux critiques comme une parenthèse dans la filmographie pasolinienne, en réalité, il y a une certaine continuité avec Oiseaux et oiseaux.
Bien sûr, ni La terre vue de la lune, la composante effrontément idéologique du film précédent est manquante, mais reste présente dans l'intrigue vaporisée par le script de conte de fées de l'histoire.
De plus, le climat général demeure: tout d'abord la joyeuse tristesse de Totò et Davoli; Dans le deuxième cas, un père et un fils de dialogue important, souligne comment les idéaux, maintenant, "sont sous les chaussures", qui sait tellement de corbeau - un personnage qui en Oiseaux d'oiseaux Il représente l'intellectuel gauche des années 60 - mangé et digéré.
D'un point de vue formel, le modèle déclaré par l'auteur est celui des comédiens de Chaplin, qui, étant muets, contenait déjà toute leur force expressive dans l'image, une raison qui, Pasolini, a conçu l'épisode avant d'atteindre un scénario.
Mais que doit être lu derrière ce choix stylistique? Appartenez-vous à une nouvelle recherche linguistique?
La réponse est probablement affirmative, car elle représente la première étape du réalisateur vers l'élaboration complète d'un langage cinématographique qui doit se passer de la conceptualisation bourgeoise du discours, et qui ne peut être comprise si elle est abordée avec les paramètres du bon sens (c'est pourquoi la terre doit être vue par le satellite lunaire).
Ce qui, explicitement, parle dans le film, c'est la couleur, délibérément surchargée (première expérience entièrement en couleur du réalisateur), qui donne la photo, une image grotesque et surréaliste, comme si la couleur avait confié la tâche de créer un sens, étant donné que le discours n'exprime plus rien, sauf le vide de la société de masse. Pour lire en ces termes, la dernière phrase du film: "Être vivant ou mort est exactement la même chose".
Serafino Murri écrit dans son beau livre dédié au cinéma de Pier Paolo Pasolini sur le moyen de longueur:
La morale du film, que l'auteur dit qu'il est tirée de la philosophie indienne, n'est pas, car la critique militante a été amenée à écrire, à renoncer et à nihiliste, car il n'y a aucune mention de consentement pessimiste avec cette affirmation: si quoi que ce soit, avec trop d'ironie, il n'y a pas assez d'invitation condamnée à ne pas accepter la logique dominante, pour être lunaire juste pour distribuer lui-même de la tenteurs. de ses schémas de marionnettes. La forme de conte de fées stigmatise donc le mensonge de la vie, une vie perdue, enterrée dans une mer de comportements grotesques et de besoins secondaires. (S. Murri, Pier Paolo Pasolini, Il Castoro, Milan, 1994, p. 77).
Carte de film:
Troisième épisode du film Sorcière. Les autres sont: Le sicilien, F. Rosi; Sens civique, M. Bolognini; La sorcière a brûlé vif, L. Visconti; Une soirée comme les autres, V. de Sica.
Sujet, scénario, direction: Pier Paolo Pasolini.
Aide de direction: Sergio Citti.
Photographie: Giuseppe Rotunno.
Scénographie: Mario Garbuglia, Piero Poletto.
Costumes: Piero Tosi.
Musique originale: Ennio Morricone.
Assemblage: Nino Baragli.
Interprètes: Totò (Ciancicato Miao), Ninetto Davoli (Baciù), Silvana Mangano (Assurina Cai), Mario Cipriani (un prêtre), Laura Betti (touriste), Luigi Leoni (épouse du touriste).
Production: Dino de Laurentis cinématographique; Les Productions Artistes Associés.
Fabricant: Dino de Laurentis.
Tir: novembre 1966; Externe: Rome, Ostia, Fiumicino; Durée: 31 minutes.
Bibliographie:
- Murri, Pier Paolo Pasolini, Castoro, Milan, 1994.
- P. Pasolini, Pasolini sur Pasolini. Conversations avec Jon Halliday, Guanda, "Library of the Fenice" Parma, 1992.
- P. Pasolini, Écrits Corsari, Garzanti, Milan, 2012.
- Sites, F. Zabagli, Pasolini. Pour le cinéma, Mondadori, "The Meridians", Milan, 2001.